Hier, suite à l'affaire du compte suisse de M. Cahuzac, les ministres du gouvernement
Ayrault ont vu leur patrimoine publié sur le site internet du
gouvernement. Certains ont profité de l'occasion pour faire de la
comm'. Ainsi, Christiane Taubira a-t-elle insisté sur le fait
qu'elle possédait 3 vélos, avec le but probablement de montrer sa
simplicité et sa proximité au peuple français. Je laisse à d'autres les commentaires sur l'étonnante faiblesse de
certains patrimoines ou sur l'impressionnant montant de certains
autres et leur compatibilité ou non avec un engagement au sein du parti
socialiste. On peut en revanche s'intéresser au principe même d'une
déclaration de patrimoine. Est-il normal de demander aux ministres
de dévoiler leurs patrimoines pour prouver leur moralité ? Est-ce que ça suffit ?
Les hommes politiques doivent être
de bons gestionnaires de biens
Le magistère ne mâche pas ses mots :
« L'amour pour les pauvres est certainement incompatible avec
l'amour immodéré des richesses ou leur usage égoïste »
(#184). S'approprier des richesses en se soustrayant à l'impôt,
c'est oublier qu'on n'est que gestionnaire de nos richesses, et c'est
se couper de l'amour des plus démunis.
Encore faut-il à titre privé ne pas
oublier que l'argent n'est qu'un moyen (pour poursuivre le bien commun),
et pas un but. C'est le principe de la destination universelle des
biens.
« Les richesses remplissent leur
fonction de service à l'homme quand elles sont destinées à
produire des bénéfices pour les autres et pour la société […]
Le mal consiste dans l'attachement démesuré aux richesses […] Le
riche n'est qu'un administrateur de ce qu'il possède » (#329
du compendium de la doctrine sociale de l'Eglise)
J'aurais donc été plus intéressé
de connaître les flux d'argents des ministres (quels investissements
et achats faits dans les 5 dernières années) que de connaître le
patrimoine aujourd'hui.
Pourquoi parler de moralisation de
la vie politique ?
Faut-il moraliser la vie politique
juste pour éviter des corruptions ou des malversations ?
Bien sûr, on pense tout de suite au
rôle d'exemplarité du monde politique. « Ceux qui exercent
des responsabilités politiques ne doivent pas oublier la dimension
morale de la représentation qui consiste dans l'engagement à
partager le sort du peuple » (#410 du comendium).
Peut-on alors s'accomoder d'un homme
politique qui n'ait aucune morale mais respecte néanmoins la loi ?
Le magistère est beaucoup plus « intrusif » que ça et
pose comme condition que chacun développe profondément tout un
ensemble de principes, faute de quoi l'Etat ne serait qu'un outil
d'optimisation des contraintes dont l'action n'aurait pas de
« sens » :
« Pour rendre la communauté publique vraiment humaine, rien
n'est plus important que de développer le sens intérieur de la
justice, de la bonté, du dévouement au bien commun, et de renforcer
les convictions fondamentales sur la nature véritable de la
communauté politique, comme sur la fin, le bon exercice et les
limites de l'autorité publique » (#392 du compendium) « Si
le septicisme venait à mettre en doute jusqu'aux principes
fondamentaux de la loi morale, l'ordonnancement étatique [se
réduirait] à un pur mécanisme de régulation pragmatique
d'intérêts différents et opposés » (#397)
Le magistère va plus loin : « L'autorité doit se
laisser guider par la loi morale : toute sa dignité dérive de
son exercice dans le domaine de l'ordre moral, lequel à son tour
repose sur Dieu, son principe et sa fin […] Cet ordre ne peut
s'édifier que sur Dieu ; séparé de Dieu, il se désintègre.
C'est précisément de cet ordre que l'autorité tire sa force
impérative et sa légitimité morale, non pas de l'arbitraire ou de
la volonté de puissance » (#396, voir aussi #577)
Difficile de mettre la foi en Dieu dans les règles d'accession
aux fonctions politiques d'envergure... D'où les appels fréquents
de l'Eglise à ce que les chrétiens s'engagent en politique. Car en
dehors de Dieu, l'unité du politique est impossible. Les chrétiens
ont donc tout leur rôle à ces postes.
Plutôt
qu'une loi supplémentaire, cherchons la conversion des hommes
La transparence des ministres sur leur situation financière est
vraisemblablement une bonne chose, et le magistère le dit
lui-même « [Dans le domaine de la communication publique et de
l'économie], l'usage sans scrupules de l'argent fait naître des
interrogations toujours plus pressantes qui renvoient nécessairement
à un besoin de transparence et d'honnêteté dans l'action
personnelle et sociale » (#198). On peut regretter qu'elle s'arrête à une photo le jour J difficile à interpréter plutôt qu'à une
déclaration visant à donner les principes suivis par les ministres
pour l'utilisation de ces richesses dans le but de poursuivre le bien
commun.
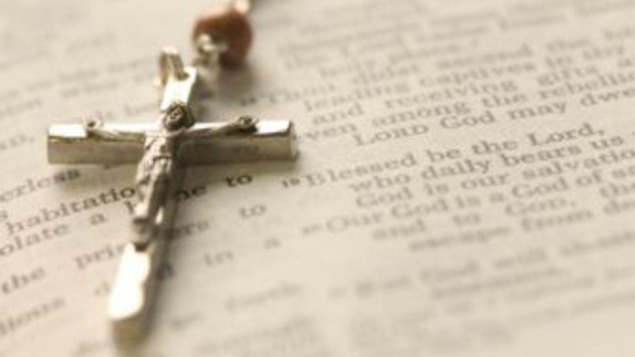 Mais ce qu'il nous faut, c'est une conversion des hommes, pas une
loi de plus. « Les Pères de l'Eglise insistent sur la
nécessité de la conversion et de la transformation des consciences
des croyants, plus que sur les exigences de changement des structures
sociales et politiques de leurs époque, en pressant ceux qui
s'adonnent à une activité économique et possèdent des biens de se
considérer comme des administrateurs de ce que Dieu leur a confié. »
(#328) « En ce qui concerne la question sociale, on ne peut
accepter la perspective naïve qu'il pourrait exister pour nous, face
aux grands défis de notre temps, une formule magique. Non, ce n'est
pas une formule qui nous sauvera, mais une Personne, et la certitude
qu'elle nous inspire : Je suis avec vous ! Il ne
s'agit pas alors d'inventer un ''nouveau programme''. Le programme
existe déjà : c'est celui de toujours, tiré de l'Evangile et
de la Tradition vivante […] le Christ lui-même. »
(#577)
Mais ce qu'il nous faut, c'est une conversion des hommes, pas une
loi de plus. « Les Pères de l'Eglise insistent sur la
nécessité de la conversion et de la transformation des consciences
des croyants, plus que sur les exigences de changement des structures
sociales et politiques de leurs époque, en pressant ceux qui
s'adonnent à une activité économique et possèdent des biens de se
considérer comme des administrateurs de ce que Dieu leur a confié. »
(#328) « En ce qui concerne la question sociale, on ne peut
accepter la perspective naïve qu'il pourrait exister pour nous, face
aux grands défis de notre temps, une formule magique. Non, ce n'est
pas une formule qui nous sauvera, mais une Personne, et la certitude
qu'elle nous inspire : Je suis avec vous ! Il ne
s'agit pas alors d'inventer un ''nouveau programme''. Le programme
existe déjà : c'est celui de toujours, tiré de l'Evangile et
de la Tradition vivante […] le Christ lui-même. »
(#577)
Bref, intéressons-nous à la vie spirituelle de nos hommes
politiques. Et engageons-nous en politique nous-mêmes si ça nous
est possible.



